
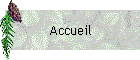
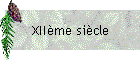
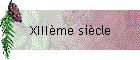
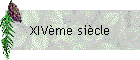
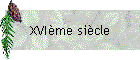
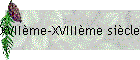
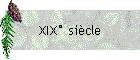
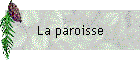
L’embellissement du XIII° s.
 Un siècle a passé. Nous voici au
début du XIII° s. La fin du règne de Philippe Auguste, le rassembleur de la
France ? Ou celui de Louis VIII le Lion ? Ou même celui de Louis IX, le futur
Saint Louis ? En tout état de cause, le pouvoir royal s’affermit, le domaine
royal (dont fait partie le Vexin français) est relativement prospère. Certes,
les paysans vivent toujours dans des maisons de torchis (ce n’est que vers le
milieu du XIX° s. qu’ils pourront construire des maisons de pierre), mais les
seigneurs et les abbayes disposent de davantage de moyens qu’auparavant.
Un siècle a passé. Nous voici au
début du XIII° s. La fin du règne de Philippe Auguste, le rassembleur de la
France ? Ou celui de Louis VIII le Lion ? Ou même celui de Louis IX, le futur
Saint Louis ? En tout état de cause, le pouvoir royal s’affermit, le domaine
royal (dont fait partie le Vexin français) est relativement prospère. Certes,
les paysans vivent toujours dans des maisons de torchis (ce n’est que vers le
milieu du XIX° s. qu’ils pourront construire des maisons de pierre), mais les
seigneurs et les abbayes disposent de davantage de moyens qu’auparavant.
 C’est
sans doute au seigneur d’Oinville que l’on doit l’embellissement de l’église.
Deux croisillons de transept sont construits de part et d’autre de la
tour-clocher. Ils sont éclairés chacun par trois lancettes, dont une subsiste
au sud et une autre dans le mur ouest du croisillon nord. Le clocher est
remanié dans un style particulier : les fenêtres jumelées rappellent le style
roman mais leur hauteur est exceptionnelle. Les colonnettes qui encadrent ces
fenêtres, les modillons cubiques qui en forment les sourcils et décorent
également le faîte de la tour confèrent à l’ensemble une sobre élégance.
C’est
sans doute au seigneur d’Oinville que l’on doit l’embellissement de l’église.
Deux croisillons de transept sont construits de part et d’autre de la
tour-clocher. Ils sont éclairés chacun par trois lancettes, dont une subsiste
au sud et une autre dans le mur ouest du croisillon nord. Le clocher est
remanié dans un style particulier : les fenêtres jumelées rappellent le style
roman mais leur hauteur est exceptionnelle. Les colonnettes qui encadrent ces
fenêtres, les modillons cubiques qui en forment les sourcils et décorent
également le faîte de la tour confèrent à l’ensemble une sobre élégance.
 La
raison d’être du transept est à la fois symbolique et utilitaire. Le
symbolisme du plan en croix latine se passe de commentaire, mais il ne saurait
à lui seul justifier de coûteux travaux. Les croisillons sont avant tout des
chapelles où le curé et son vicaire peuvent chaque jour célébrer la messe en
présence d’un servant d’autel. L’autel, sans doute très dépouillé, est
installé contre le mur est de chacun des croisillons.
La
raison d’être du transept est à la fois symbolique et utilitaire. Le
symbolisme du plan en croix latine se passe de commentaire, mais il ne saurait
à lui seul justifier de coûteux travaux. Les croisillons sont avant tout des
chapelles où le curé et son vicaire peuvent chaque jour célébrer la messe en
présence d’un servant d’autel. L’autel, sans doute très dépouillé, est
installé contre le mur est de chacun des croisillons.
 Pour la
population du village, cela ne change pas grand-chose. Simplement, l’espace
sous le clocher est désormais éclairé par les fenêtres du transept. Pour
le reste, on est toujours debout dans la nef, et on assiste à l’office plus
qu’on n’y participe. Peut-être la « porte des morts » percée dans le
croisillon sud date-t-elle de cette époque. Après la cérémonie, le défunt,
qui avait été transporté par le portail principal, est emporté vers le
cimetière sur un brancard à deux porteurs à travers cette porte. Le
cimetière se trouve en effet à l’emplacement du futur parvis, sur une
surface remblayée soutenue par un mur à l’est, au-dessus de la rue.
Pour la
population du village, cela ne change pas grand-chose. Simplement, l’espace
sous le clocher est désormais éclairé par les fenêtres du transept. Pour
le reste, on est toujours debout dans la nef, et on assiste à l’office plus
qu’on n’y participe. Peut-être la « porte des morts » percée dans le
croisillon sud date-t-elle de cette époque. Après la cérémonie, le défunt,
qui avait été transporté par le portail principal, est emporté vers le
cimetière sur un brancard à deux porteurs à travers cette porte. Le
cimetière se trouve en effet à l’emplacement du futur parvis, sur une
surface remblayée soutenue par un mur à l’est, au-dessus de la rue.
Sur
la photo de gauche, on peut voir la tour clocher à partir des combles. Une
petite porte sur chaque face permet la circulation entre les combles de la nef,
du choeur et des croisillons de transept (encore inexistants au XII° s.). Au
dessus de la porte, on voit les fenêtres géminées "mangées" par la
toiture du XVI° s.
 La
"porte des morts" donnait sur le cimetière. Elle était appelée
ainsi car c'est par cette porte que le défunt, porté sur un brancard par deux
hommes, quittait l'église pour sa dernière demeure. Elle a été restaurée
sous l'aspect d'une niche car le bas de son encadrement a disparu. On voit
encore son seuil à l'extérieur, il donne une idée du niveau du sol du
cimetière, qui dominait la rue.
La
"porte des morts" donnait sur le cimetière. Elle était appelée
ainsi car c'est par cette porte que le défunt, porté sur un brancard par deux
hommes, quittait l'église pour sa dernière demeure. Elle a été restaurée
sous l'aspect d'une niche car le bas de son encadrement a disparu. On voit
encore son seuil à l'extérieur, il donne une idée du niveau du sol du
cimetière, qui dominait la rue.